 « Je veux me planter au beau milieu de ce que les gens appellent des “atrocités” et dire et répéter : “la vie est belle” », écrit Hetty Hillsum dans son Journal intime. Comment la joie et la tristesse peuvent-elles ainsi cohabiter au centre de notre expérience humaine ?
« Je veux me planter au beau milieu de ce que les gens appellent des “atrocités” et dire et répéter : “la vie est belle” », écrit Hetty Hillsum dans son Journal intime. Comment la joie et la tristesse peuvent-elles ainsi cohabiter au centre de notre expérience humaine ?
Evoquant avec des amis un récent week-end familial en Normandie et leur rapportant les sources d’émerveillement de ces trois jours, j’ai été surpris par la liste que j’en faisais, où se mêlaient la joie et les larmes :
Emerveillement : dans un pré en bordure de la mer, dans les environs d’Omaha Beach, crinière au vent et galopant de conserve, deux juments, l’une à la robe noir de jais, l’autre d’un bel alezan fauve, semblent danser sur un air de jeunesse et de liberté ; cimetière allemand et jardin de la paix de La Cambe terriblement triste et digne où j’ai simplement pleuré ; bouleversement le lendemain en lisant des lettres à leur mère de jeunes soldats américains tués dans la bataille de Normandie, puis en découvrant au Mémorial de Caen les photos de ces femmes juives ukrainiennes quelques minutes avant d’être abattues d’une balle dans la nuque ; émerveillement devant deux vues de Venise par Guardi au musée de Caen, puis quelques heures plus tard devant le ciel étoilé avec au loin le chant des grenouilles dans la nuit ; bonheur tendre et simple d’un après pic-nic au bord d’un ruisseau enchanteur, où avec nos enfants nous avons sorti crayons, fusain et aquarelle pour saisir chacun avec sa sensibilité l’impression des lieux ; jouissance de la sensation du sable tiède sur la peau en contemplant le camaïeu de couleurs bleu et brun formé par le ciel, la mer et la plage ; petits-déjeuners de rêve offerts avec grâce dans la chambre d’hôte où nous étions hébergés ; le sourire de la femme que j’aime ; émotion et sérénité pour finir au cimetière américain de Colleville-sur-Mer face aux alignements impeccables des tombes, symbole de fraternité humaine rehaussée par le mélange des croix chrétiennes et des étoiles juives.
Une manière d’être au monde 
Comment osais-je parler d’émerveillement alors que j’évoque des émotions pleines de vie à côté de ce déchirement de tout l’être suscité par la mort et ces larmes impossibles à retenir face aux photos du massacre des juifs en Europe central, cette horreur sans nom que l’on appelle la shoah par balles ?
Sur le moment, je n’ai pas cherché à comprendre, car ces émotions, loin d’être successives, se mélangeaient au point de ne plus se distinguer. Mais toutes me nourrissaient et me nourrissent encore pour longtemps. En outre, ces émotions se sont cristallisées dans un sentiment intérieur profond de joie intérieure inaltérable et sereine. Comment était-ce possible ?
Relisant Hetty Hillsum, je tombais sur cette phrase : « Je veux me planter au beau milieu de ce que les gens appellent des “atrocités” et dire et répéter : “la vie est belle”. »
Hetty écrit cela dans son Journal intime le 8 octobre 1942. Un an plus tard, elle mourrait à Auschwitz.
Cette réflexion n’est pas juste une réaction isolée, mais bien une façon d’être au monde qui tient compte de tous les éléments contradictoires de la réalité, attitude qu’Etty a mûrie et fait éclore peu à peu, comme en témoigne cette réflexion, le 23 septembre 1942 : « C’est comme une petite vague qui remonte toujours en moi et me réchauffe, même après les moments les plus difficiles : “Comme la vie est belle pourtant !” C’est un sentiment inexplicable. Il ne trouve aucun appui dans la réalité que nous vivons en ce moment. Mais n’existe-t-il pas d’autres réalités que celle qui s’offre à nous dans le journal et dans les conversations irréfléchies et exaltées de gens affolés ? Il y a aussi la réalité de ce petit cyclamen rose indien et celle aussi du vaste horizon que l’on finit toujours par découvrir au-delà des tumultes et du chaos de l’époque. »
Une vérité double et énigmatique
Dans son ouvrage De l’émerveillement, Michael Edwards note que « le comble de l’émerveillement contient et la grande joie et la grande détresse ». En analysant Le Conte d’Hiver, il note que pour Shakespeare, l’émerveillement est « la réaction la plus intense et la plus vraie aux deux extrêmes de notre expérience, au pire absolu comme au meilleur absolu ». « L’écrivain et le peintre, poursuit Michael Edwards, créent normalement les signes de l’émotions ressentie, mais une des propriétés de la musique, lorsqu’elle atteint une certaine limite (comme dans quelques adagios de Beethoven), est de susciter un émerveillement où l’on ne sait jamais si l’on rit ou si l’on pleure, comme si la joie et la tristesse n’étaient pas simplement des émotions contrastées mais l’indice d’une vérité double et énigmatique au cœur du réel. »
Michael Edwards n’hésite pas à situer la « co-présence de la joie et de la tristesse au centre de l’expérience humaine ». L’extrême limite de l’émotion, qui caractérise le moment de l’émerveillement, nous donne parfois l’impression de déborder. Ce sentiment se retrouve dans les adages populaires : « exploser de joie » ou « être hors de soi ». Quand nous ressentons cet éclair de joie, nous nous retrouvons alors à la fois sur les hauteurs et dans les profondeurs de l’être et du monde.
La joie comme récompense
 Ce mélange des sentiments est une expérience presque commune pour le marcheur et le montagnard. En effet, la marche, comme l’explique selon Frédéric Gros, auteur inspiré de Marcher, une philosophie, entraîne de la joie, mais aussi de la fatigue et de l’ennui. Pourtant, au bout de la marche, c’est la joie qui domine. « Après toute une journée de marche, le simple délassement pris à étendre les jambes, à se rassasier simplement, se désaltérer tranquillement et contempler un jour qui finit, un soir qui tombe doucement. Le corps sans fin ni soif, sans souffrances, le corps en repos, et de et de sentir simplement vivre cela suffit à la joie la plus haute, d’une intensité pure, d’une modestie absolue : celle de vivre, de se sentir ici, de goûter sa présence et celle du monde en harmonie. »
Ce mélange des sentiments est une expérience presque commune pour le marcheur et le montagnard. En effet, la marche, comme l’explique selon Frédéric Gros, auteur inspiré de Marcher, une philosophie, entraîne de la joie, mais aussi de la fatigue et de l’ennui. Pourtant, au bout de la marche, c’est la joie qui domine. « Après toute une journée de marche, le simple délassement pris à étendre les jambes, à se rassasier simplement, se désaltérer tranquillement et contempler un jour qui finit, un soir qui tombe doucement. Le corps sans fin ni soif, sans souffrances, le corps en repos, et de et de sentir simplement vivre cela suffit à la joie la plus haute, d’une intensité pure, d’une modestie absolue : celle de vivre, de se sentir ici, de goûter sa présence et celle du monde en harmonie. »
La marche, métaphore idéal de notre condition humaine de pèlerin, nous offre ici une belle leçon de vie : sans l’effort préalable, sans avoir vécu la faim, la soif ou l’ennui, cette joie ne serait pas advenue.
Nous faisons une expérience similaire en montagne. Avez-vous déjà observé la différence entre la découverte d’un panorama après une montée en voiture d’une demi-heure et celle d’une demi-journée de marche ? Dans le premier cas, nous sommes heureux de découvrir la beauté du spectacle, dans le second, nous sommes inondés d’un sentiment de plénitude et de joie intense. Car le panorama s’offre alors comme une récompense de la marche, comme un accomplissement, un aboutissement. Comme si là-haut, suite à l’effort, tout devenait léger, tous les nœuds de dénouaient pour libérer la joie et nous révéler à nous-mêmes. « Solvitur in excelsis. » La solution est au plus haut, sur les cimes. A condition toutefois, d’être venu des profondeurs, d’avoir arpenté le paysage intérieur en laissant le manque, la soif et la faim creuser en nous ce besoin d’absolu. Mais l’un ne va pas sans l’autre. Nous ne touchons la joie des dieux qu’à condition de garder les pieds dans la poussière du chemin, en compagnie de nos frères humains. Sans eux, personne avec qui partager la route, personne à qui laver les pieds, personne à qui offrir sa joie.
Read Full Post »








 L’enfant s’étonne encore de découvrir une fraise des bois sur le bord du chemin ; il peut jouer des heures avec une feuille et un bâton qu’il transforme au gré de son imagination en bateau ou en drapeau ; il se jette dans les bras de sa maman à la sortie de l’école sans crainte du qu’en dira-t-on… Il porte sur les êtres et les choses un regard encore neuf. Une multitude d’événements insolites traversent sa vie et le bouleversent. Et il vit ces événements avec la totalité de tout son être. L’enfant il laisse libre cours à ses émotions sans les réfréner, son corps les extériorise, son esprit les boit littéralement, transformant ces événements en expériences inscrites sur le papier buvard de sa mémoire.
L’enfant s’étonne encore de découvrir une fraise des bois sur le bord du chemin ; il peut jouer des heures avec une feuille et un bâton qu’il transforme au gré de son imagination en bateau ou en drapeau ; il se jette dans les bras de sa maman à la sortie de l’école sans crainte du qu’en dira-t-on… Il porte sur les êtres et les choses un regard encore neuf. Une multitude d’événements insolites traversent sa vie et le bouleversent. Et il vit ces événements avec la totalité de tout son être. L’enfant il laisse libre cours à ses émotions sans les réfréner, son corps les extériorise, son esprit les boit littéralement, transformant ces événements en expériences inscrites sur le papier buvard de sa mémoire.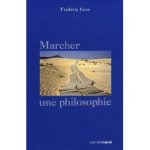 hie
hie Comment l’émerveillement vient-il ? Comment naît-il en nous ? Faut-il le vouloir, le faire advenir, se mettre « en état de » sentir l’émerveillement ?
Comment l’émerveillement vient-il ? Comment naît-il en nous ? Faut-il le vouloir, le faire advenir, se mettre « en état de » sentir l’émerveillement ? Un extrait du récent roman d’Isabelle Desesquelles :
Un extrait du récent roman d’Isabelle Desesquelles :  « Je soutiendrais volontiers que les remerciements sont la plus haute forme de pensée et que la gratitude est un bonheur doublé d’émerveillement », assurait l’écrivain anglais G. K. Chesterton, qui garda toute sa vie un sens très juvénile de l’émerveillement, joint à un sens formidable de l’humour.
« Je soutiendrais volontiers que les remerciements sont la plus haute forme de pensée et que la gratitude est un bonheur doublé d’émerveillement », assurait l’écrivain anglais G. K. Chesterton, qui garda toute sa vie un sens très juvénile de l’émerveillement, joint à un sens formidable de l’humour.